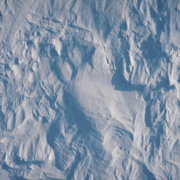Quand les musées soignent : l’art devient un allié du bien-être, du care au cure.
Un ouvrage pionnier explore comment les musées, en croisant arts, santé et société, deviennent des acteurs clés du bien-être et du soin.
Le musée qui soigne : Du care au cure, la muséothérapie est un projet éditorial majeur codirigé par le Dr Olivier Beauchet (Université de Montréal) et Nathalie Bondil (Institut du Monde Arabe, Paris). Pour la première fois, un ouvrage interdisciplinaire francophone — à portée internationale — explore en profondeur les liens entre musées, arts visuels et santé.
À l’heure où les enjeux de santé mentale et de cohésion sociale s’intensifient, les musées réinventent leur rôle. Ils ne sont plus seulement des lieux de contemplation, mais deviennent des espaces de bien-être, de soutien et d’accompagnement. Cette évolution s’inscrit dans des tendances mondiales fortes :
– L’OCDE et l’ICOM (2019) reconnaissent les musées comme lieux de soin individuel et collectif.
– L’OMS Europe (2019) confirme scientifiquement l’impact positif des arts sur la santé mentale et physique.
– La pandémie de COVID-19 a accéléré l’innovation culturelle au service du mieux-être.
L’ouvrage montre comment les arts peuvent être intégrés de manière rigoureuse et fondée sur les preuves au sein des pratiques de santé. Il s’adresse autant aux professionnels de la culture et de la santé qu’aux usagers, décideurs, artistes, éducateurs et chercheurs. La muséothérapie y est pensée comme une approche humaniste : inclusive, participative et profondément ancrée dans les humanités médicales et la médecine intégrative.
Au fil d’une vingtaine de chapitres théoriques et d’une cinquantaine de fiches pratiques, le livre présente :
– les mécanismes par lesquels les arts favorisent le bien-être ;
– des interventions muséales innovantes et reproductibles ;
– des ponts concrets entre institutions culturelles, secteurs de soins et communautés.
Fédérant des expert·es internationaux, Le musée qui soigne propose une nouvelle vision du musée : un acteur essentiel de santé publique, capable de soutenir la qualité de vie, la résilience et le lien social.
La publication est prévue en 2026.